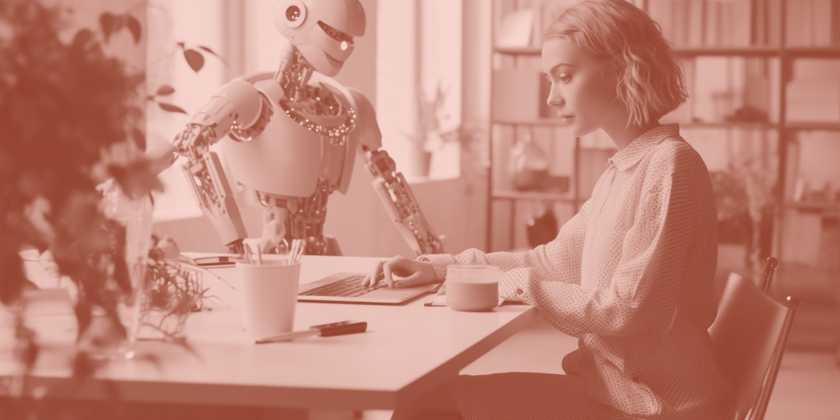L’importance du prompt engineering dans un monde numérique en évolution
Il y a quelques années, nous nous émerveillions devant la capacité des intelligences artificielles génératives à produire du texte, des images ou du code. Aujourd’hui, nous réalisons que la véritable différence ne réside pas seulement dans la puissance des modèles comme ChatGPT, Mistral, Gemini ou DeepSeek, mais dans la manière dont nous leur parlons.
L’art de concevoir des prompts efficaces — ce que l’on appelle le prompt engineering — est devenu une compétence clé. Bien le maîtriser ne relève pas seulement du confort d’usage : c’est aussi un enjeu écologique et une façon de limiter les fameuses “hallucinations” de l’IA. Apprendre à prompter avec efficacité et sobriété, c’est donc apprendre à réduire la pollution numérique tout en obtenant des résultats fiables.
Moins de mots, moins de carbone, plus de justesse
Chaque requête adressée à un modèle génère une consommation d’énergie. Plus un échange est long, plus il sollicite des serveurs, et plus son empreinte carbone augmente. Écrire un prompt clair, précis et bien cadré, c’est réduire la quantité de calculs nécessaires. En d’autres termes, un prompt bien conçu est un acte de sobriété numérique.
À l’heure où la transition écologique s’invite dans toutes les stratégies d’entreprise, il est essentiel de rappeler qu’un bon usage de l’IA peut être aligné avec une démarche durable. Chez Digital4Better, entreprise dédié au numérique responsable, cette idée est au cœur de l’accompagnement que nous proposons aux organisations.
Former les équipes à “parler efficacement” aux IA génératives, c’est réduire leur consommation énergétique, leurs coûts, et leur frustration quotidienne face à des réponses approximatives.
Les hallucinations : quand l’IA invente
Toute personne ayant déjà utilisé ChatGPT ou Gemini a été confrontée à ce phénomène troublant : l’IA répond avec aplomb, mais son contenu est faux. Une référence inventée, une statistique sans fondement, un auteur fictif. Ces hallucinations sont l’un des grands défis actuels des modèles génératifs.
Un prompt vague ou mal structuré augmente ce risque. À l’inverse, un prompt contextualisé, cadré et soutenu par des sources fiables permet de réduire significativement les erreurs. Par exemple, demander à un modèle : “Selon les données publiées par l’OMS, résumez-moi les principales causes de pollution de l’air” a plus de chances d’aboutir à un résultat rigoureux qu’un simple “Quelles sont les causes de la pollution de l’air ?”.
Une étude récente en santé publique (focus sur les questions liées au cancer) a révélé des écarts frappants en matière de fiabilité des réponses des IA :
- Les chatbots classiques affichaient ~40 % d’hallucinations sur les questions posées
- Les versions RAG (Retrieval-Augmented Generation) adossées à une source validée (comme le National Cancer Center) réduisaient ce taux à :
- 0 % avec GPT-4,
- 6 % avec GPT-3.5, pour les questions couvertes par la source fiable.
À l’inverse, un système RAG branché sur des sources web génériques maintenait un taux d’erreur entre 6 et 10 %, grimpant même à 19–35 % lorsque la source ne couvrait pas le sujet.
Le constat est clair : un cadrage précis des requêtes + des sources fiables transforment radicalement la fiabilité des réponses. Dans des domaines critiques comme la santé, la finance ou l’éducation, cette rigueur n’est pas un luxe – elle est indispensable pour garantir la qualité et l’impact des projets.
De la technique au savoir-faire
Le prompt engineering est souvent présenté comme une série de techniques : donner un rôle à l’IA (“Vous êtes un expert en…”), découper une tâche en étapes successives, inciter l’IA à expliciter son raisonnement étape par étape, ou encore utiliser des systèmes dits RAG (Retrieval-Augmented Generation) qui lui permettent de consulter des sources avant de répondre.
Ces méthodes sont efficaces, mais leur force ne réside pas uniquement dans la technique. Elles relèvent surtout d’un savoir-faire humain : clarifier ce que l’on veut vraiment, organiser la pensée en amont, et traduire cette exigence en quelques lignes adressées à l’IA. En ce sens, le prompt engineering rapproche plus de l'art rhétorique que du code informatique.
Un bon prompteur ne se contente pas de connaître les “trucs” : il sait anticiper, cadrer et simplifier. Il est capable d’aligner la machine avec l’intention humaine.
Des outils qui évoluent avec nous
Les grands modèles ne cessent de progresser. ChatGPT continue d’intégrer des options de mémoire pour s’adapter à l’utilisateur au fil du temps. Mistral avec son approche européenne, cherche à concilier performance et transparence. Gemini, chez Google, mise sur l’intégration multi-modalité (texte, image, son). Et DeepSeek, plus récemment, explore des approches réflexives où l’IA “relit” sa propre réponse avant de l’envoyer, réduisant ainsi ses erreurs.
Ces avancées sont passionnantes. Mais elles ne dispensent pas de l’essentiel : savoir poser la bonne question. Une IA capable d’écrire un roman ou de coder une application reste tributaire de l’intention qu’on lui donne. L’utilisateur conserve la clé.
Sobriété et pédagogie : former pour mieux agir
Comment sensibiliser les équipes à cette nouvelle compétence ? La pédagogie est la réponse. Des ateliers pratiques, où chacun apprend à reformuler ses prompts, à comparer les résultats selon différentes formulations, sont souvent plus parlants que des cours magistraux.
Voir de ses propres yeux qu’une petite variation de phrase peut diviser par deux le nombre de tokens consommés ou rendre une réponse deux fois plus fiable, c’est un déclic puissant.
Digital4Better accompagne justement les organisations dans cette démarche. En intégrant la sobriété numérique comme principe fondateur, nos équipes aident à concevoir des templates simples, reproductibles et efficaces. Par exemple, une structure “Rôle + Contexte + Tâche + Format + Ton” permet à chacun, même débutant, de gagner en efficacité. Nous encourageons également à systématiser le format attendu en sortie (éviter les schémas, limiter le nombre de tokens ou de pages A4).
L’objectif n’est pas de transformer les collaborateurs en experts en IA, mais de les rendre autonomes dans un usage raisonné et responsable.
Vers une culture du prompt responsable
À terme, maîtriser le prompt engineering ne sera plus un luxe, mais une compétence de base, comparable à la maîtrise de la bureautique hier ou d’Internet aujourd’hui. Les entreprises qui prennent ce virage tôt s’assurent un double bénéfice : une meilleure efficacité opérationnelle et une empreinte numérique plus légère.
Car oui, le numérique durable n’est pas qu’une affaire de serveurs plus verts ou de cloud mieux optimisé. Il commence dans nos pratiques quotidiennes, dans la manière dont nous interagissons avec la machine. Chaque prompt est une décision. Chaque phrase inutile est une ligne de calcul superflue.
Cultiver une culture du prompt responsable, c’est apprendre à dire plus avec moins, à demander juste ce qu’il faut, et à vérifier ce qui est produit. C’est aussi partager cette culture dans les organisations, pour qu’elle devienne un réflexe collectif.
Bien parler aux IA, c’est mieux parler au futur
Le prompt engineering ne doit pas être perçu comme une discipline obscure réservée aux initiés. C’est un outil accessible, une pratique à la fois simple et puissante, qui permet d’aligner la technologie avec nos besoins réels.
En apprenant à prompter de manière efficace et sobre, nous devenons non seulement de meilleurs utilisateurs d’IA, mais aussi des acteurs plus responsables du numérique. Nous réduisons le gaspillage énergétique, nous améliorons la fiabilité des outils, et nous préparons nos organisations à une transformation qui ne fait que commencer.
Avec des acteurs comme Digital4Better, les entreprises disposent d’un accompagnement concret pour franchir ce cap. Former, sensibiliser, outiller : c’est ainsi que l’on construit une relation saine avec les intelligences artificielles génératives.
Et si, finalement, l’avenir du numérique durable ne dépendait pas seulement des machines, mais surtout de la manière dont nous interagissons avec elles ?
Merci à notre consultant Jean-Christophe Bories pour son expertise sur le sujet et pour son aide dans la rédaction de cet article.